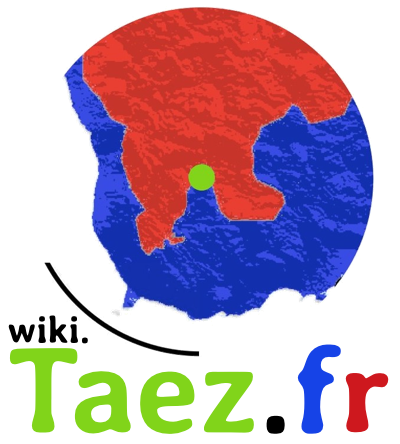Table des matières
Sur l'accueil du wiki du 25 mars au 4 juillet 2025 (version archivée).
L’échec d’une thèse en question
21-25 mars 2025
(21-25 ramadan 1446)
Je m’appelle Vincent Planel, je suis né à Paris en 1980, je suis anthropologue indépendant. À l’âge de 33 ans (2013), j’ai été contraint d’abandonner une thèse d’anthropologie consacrée à la société yéménite, centrée sur Taez la troisième ville du pays. Un projet auquel j’avais consacré quasiment toute ma vie d’adulte, depuis mes premiers pas dans l’apprentissage de l’arabe (1998-1999) et mon premier voyage dans ce pays (juillet 2001). Titulaire d’une maîtrise de physique, j’ai pu travailler par intermittence comme prof de maths et sciences, mais les sciences sociales restent ma véritable passion. J’ai finalement repris l’écriture en 2018, de manière publique et totalement autonome : d’abord sous forme d’un site classique (html), puis depuis janvier 2022 sur ce site dokuwiki.
L’échec de cette thèse est en fait assez simple à comprendre. J’ai abandonné ma thèse en 2013 faute d’avoir pu traiter un incident survenu dix ans plus tôt, indissociable de mon premier passage à l’écriture (octobre 2003). Incident sur lequel j’ai finalement écrit après 2018, sur le mode autobiographique, mais dont les implications méthodologiques et philosophiques restent un tabou jusqu’à ce jour en France, dans les milieux académiques aussi bien que musulmans. Toutes mes recherches actuelles découlent de ce constat.
Problématique de la thèse (2005-2006)
Dans cette thèse commencée en 2005, j’essayais de saisir la structure sociale locale à partir d’observations situées de la sociabilité masculine. Je me focalisais notamment sur un registre de boutades homoérotiques*, particulièrement présentes dans la culture urbaine de cette ville : un registre vulgaire auquel devaient se « former » les nouveaux venus, quitte à surmonter leur pudeur naturelle (régions rurales alentours), à contredire les valeurs tribales (région de Sanaa) autant que les valeurs modernistes (Aden). Au Yémen, Taez était la Capitale de l’éducation, mais elle était aussi la Capitale de la vulgarité. L’art des boutades y semblait indispensable aux transactions sociales quotidiennes, dans une grande part de la population citadine - avec bien sûr des nuances selon les milieux.
Tout le problème de ma thèse était d’interpréter correctement ce phénomène, en lien avec les problématiques politiques, économiques, démographiques de cette période. Mes observations touchaient au cœur du climat social de cette ville, quelques années en amont des Printemps Arabes. Au début de l’année 2011, alors que je m’efforce de terminer cette thèse, la population de Taez se démarque brusquement et sort en masse « contre la corruption », avant que les Places du Changement ne gagnent l’ensemble du pays. Mais de quelle corruption s’agit-il au juste ? Qualifier cette corruption de manière rigoureuse, c’était qualifier les Printemps Arabes eux-mêmes, et dégager potentiellement la trajectoire historique ultérieure.
La rigueur scientifique, dans ce genre d’étude anthropologique, exige un effort de transparence réflexive*. Le chercheur doit être au clair sur la position qu’il a occupé comme observateur : les circonstances dans lesquelles il a eu accès à ces boutades, pourquoi on lui a permis d’effectuer cet apprentissage, en lien avec quelle configuration sociale locale.
• Si le chercheur ne fait pas ce travail réflexif, la valeur scientifique de toutes ses observations sera très limitée.
• Inversement, si on l'empêche de mener ce travail réflexif jusqu’à son terme, on empêche un chercheur sérieux de livrer la moindre de ses observations.
C’est ce qui s’est passé ici.
Dans mes principaux textes sur le Yémen, on trouvera quelques textes de jeunesse, ou des textes produits dans des circonstances très particulières (un texte de candidature, un colloque sur « les homosexualités », un dialogue avec un politiste l’année des Printemps Arabes…). On trouvera aussi quelques chapitres qui étaient censés constituer les piliers de ma thèse (mis en ligne dans ma cargaison de décembre 2017). Mais jusqu’à aujourd’hui, l'essentiel de mes observations dort dans les profondeurs de mon disque dur : des mois et des années de notes, qui restent inexploitables jusqu’à ce jour, faute de reconnaissance de notre alliance d’enquête*.
Un parti pris laïque (2007)
Bien sûr, on dira qu’un élément manque à cette présentation : ma conversion à l’islam. On dira qu’un doctorant normal n’abandonne pas sa thèse sous prétexte qu’on refuse de concevoir son alliance d’enquête, la position qu’il a occupée sur le terrain, ou plus exactement de voir celle-ci comme il la voit lui.1) On dira en somme que l’échec de ma thèse est lié à ma « radicalisation »…
Je connais bien sûr ces objections, et je les conteste formellement depuis l’origine. Je les conteste parce que ma conversion à l’islam intervient en début de troisième année de thèse (septembre 2007), alors que je travaille à cet endroit depuis quatre ans (dont douze mois de présence sur place) : elle intervient au moment où je dois me retirer pour rédiger. J’ai mentionné cette conversion à titre informatif, pour qu’on comprenne la trajectoire de mon positionnement, mais je n’ai pas ajouté d’observations nouvelles après cette date, ou des problématiques qui ne figuraient pas dans le projet de départ : j’ai continué d’assumer le corpus constitué antérieurement, c’est-à-dire l’ensemble des perceptions situées d’homoérotisme. Car la corruption de cette société était réelle, ce climat de soupçon et d'enjouement généralisé. Ce que j'appelais « homoérotisme » n'était pas simplement lié à mon refus antérieur de me convertir, et n’allait pas disparaître avec ma conversion. Je revendiquais juste le droit de l'analyser autrement après coup, conformément aux fondamentaux de la méthode ethnographique (voir la leçon de Florence Weber).
Bien sûr, cette position est intimement liée à des paramètres personnels, sur lesquels je gardais le silence à l’époque : ce qui s’était passé dans ma vie en marge du terrain, à quel moment j’ai pu me considérer homosexuel, est-ce que je l’étais vraiment, etc.. J’en ai dit un peu plus ces dernières années à travers ce site, en reprenant l’histoire sur le mode autobiographique. Mais à l’époque, dans le cadre de ma thèse et du régime qui prévalait alors, j’ai toujours gardé le silence. En termes méthodologiques, je traitais l’homosexualité de l’observateur comme une modalité de l’« être affecté ». C’est ce qui permettait une certaine rigueur dans l’analyse des comportements, de ne pas prêter aux Yéménites tel ou tel « degré d’homosexualité » ou de « masculinité », car cette démarche ne m’intéressait pas. Passé mes premiers tâtonnements, mon analyse s’est voulue résolument situationnelle, et c’est dans cette approche qu’elle a trouvé sa cohérence.
Pour revenir aux soupçons de « radicalisation », je les conteste pour une raison fondamentale : on n’a pas à juger la manière dont je suis sorti du terrain, ma vie personnelle à l’heure où je rédige ma thèse. La validité d’une démarche ethnographique n’a pas à être évaluée à l’aune d’implications idéologiques présumées. D’ailleurs chaque chercheur est différent : je n’ai jamais exclu qu’un autre ait pu s’en tirer autrement. Mais que l’on voie là une menace existentielle, dans le fait qu’un anthropologue travaillant sur un terrain musulman se soit converti à l’islam, cela en dit long sur l’état des institutions de ce pays.
Fort heureusement, mes interlocuteurs académiques directs m’ont toujours épargné ce type de réponse. Mais en même temps, le caractère fondamentalement laïque de cette démarche n’a pas vraiment été souligné. Pour moi il allait de soi, je ne pensais pas à le mettre en avant à l’époque, et il n’a jamais été soutenu pour lui-même. On n’a pas su voir, derrière cette intrigue d’ethnographie et d’homoérotisme, un enjeu fondamental de laïcité (que l’on comprendra mieux plus loin), un enjeu pour le rapport au monde de la France, plus généralement. C’est bien dommage, au vu de la tournure du débat public dans ce pays depuis quinze ans - où la confession homosexuelle semble souvent constituer, de fait, l’horizon indépassable de la réflexivité sociologique…
L’alignement des planètes (2008-2010)
Pour comprendre les conditions de mes observations, il suffit en fait d’ouvrir les yeux sur cette photo, qui constitue le « clip de fin » de mon enquête au Yémen2).

La photo est prise le 17 novembre 2008, la veille de mon retour en France au terme de mon cinquième séjour à Taez. Je suis assis à l’entrée du quartier avec plusieurs de mes interlocuteurs-clé, à proximité immédiate de leurs maisons respectives, pour une partie de qat solennelle (la mise en scène est totalement de leur fait). De droite à gauche : Yazid, moi puis Ziad (les deux frères), ainsi que Waddah (leur cousin maternel). Les passants s’arrêtent, se font prendre en photo avec nous (ici deux voisins, Mustafa et Omar), et le rituel dure ainsi tout l’après-midi.
L’image ne va pas de soi, que ces trois personnes s’assoient autour de moi pour la photo. Ziad a mis le feu au salon dix-huit mois plus tôt, au tout début de mon précédent séjour (19 août 2007) ; il vient de passer un an en prison, et les rapports avec son frère Yazid restent difficiles. Quant à Waddah, il appartient à une branche rivale de la famille : en voulant s’insérer maladroitement dans l’intrigue de ma première enquête, quatre ans plus tôt, il a été à l’origine du nœud « homosexuel » de toute cette affaire (octobre 2003). Donc ces personnes ont donné de leur personne, c’est peu dire, et les sujets de désaccord entre elles ne manquent pas. Si elles se rassemblent ce jour-là, c’est précisément pour témoigner d’une alliance d’enquête, matérialisée par la caméra.
Ce 17 novembre 2008 est le seul jour où j’ai sorti la caméra vidéo : il y a aussi des images filmées de cette scène. Images que je n’ai mises en ligne qu’en 2018, dix ans plus tard, car elles n’avaient aucune vocation académique au départ. Il n’empêche : on peut y voir l’état de mes rapports au terme de mon enquête, avec mes principaux interlocuteurs parmi les citadins, les commerçants et les journaliers. Si une chose y transparaît clairement, quelque soit le milieu considéré, c’est la dimension réflexive de cette alliance « homoérotique », totalement assumée devant la caméra. C’est le fil conducteur de presque toutes les scènes filmées : mes interlocuteurs prennent à cœur de rendre transparentes les ficelles « homoérotiques » de l'enchantement ethnographique. Et ce n’est évidemment pas sans lien avec le fait d’avoir su réunir sur un même plateau Waddah et Ziad - respectivement informateur et interlocuteur de ma première enquête - sous l’autorité de Yazid.
Cette alliance, publiquement assumée, est totalement en phase avec ma candidature au Prix Michel Seurat du CNRS, déposée depuis Taez quinze jours plus tôt. Le texte est encore centré sur la problématique « homoérotique », mais j’exprime clairement ma volonté de passer outre : grâce à une alliance d’enquête renouvelée sur d’autres bases - ma conversion à l’islam étant citée dans une note de bas de page (n°7) - et avec une autre analyse rétrospective de toute l’affaire, fondée sur mon petit théorème de l’enchantement ethnographique.
Bas de la page 4 : « …Autant dire que cette première rencontre [en 2003 avec Ziad] a été pour moi la source d’un trouble et d’une culpabilité durables. Or à présent, je me demande si mon enthousiasme “passionnel” ne dérivait pas simplement de la situation ethnographique, et du talent particulier de Ziad à en tirer parti en étant à la fois “l’indigène” et “l’informateur”, “l’Autre” tout en étant “l’Ami”. Cette double posture n’est-elle pas ancrée dans le fonctionnement-même de la sociabilité masculine ? »
Si cette étude microscopique a échoué, c’est parce qu’elle butait - avant 2011 - sur un non-dit historique plus large, dont personne n’avait la clé. Je n’ai pas échoué faute de soutien de mes interlocuteurs (la photo en témoigne), ni faute de soutien académique (lettres d’appui à ma candidature, adressées par Jocelyne Dakhlia et Florence Weber). En fait au contraire, j’ai même bénéficié des deux côtés d’une adhésion réelle à ce que je tentais de faire, d’une compréhension profonde des enjeux fondamentaux que je tentais de pointer. En temps ordinaire, il n’en faut pas plus pour qu’une thèse aboutisse.
Tant que nous y sommes, mentionnons aussi l’aspect matériel et financier. Après la fin de ma bourse de thèse (2005-2008), je n’ai pas voulu me déclarer au chômage : c’était à l’évidence ma conversion à l’islam qui retardait l’achèvement de ma thèse, et je ne voulais pas qu’on vienne me chercher des noises (c’était le début du quinquennat Sarkozy). Je n’avais donc aucune ressource, mais j’ai été hébergé dans cette période par ma mère, à titre gratuit. Avec les 15 000€ du Prix Michel Seurat, obtenu au Printemps 2009, j’ai donc pu tenir plusieurs années.
Côté musulman aussi, je jouissais d’un certain soutien, dans la petite communauté étudiante que je fréquentais à l’époque (Résidence Universitaire d’Antony). Pas un franc soutien intellectuel, mais au moins le soutien d’une camaraderie quotidienne « entre étudiants », c’était déjà beaucoup. La plupart de ces frères connaissaient mon histoire avec le Yémen, cette histoire un peu bizarre mêlant homosexualité et schizophrénie, dans un pays qui leur était peu familier (la plupart venaient du Maghreb ou d’Afrique Subsaharienne). Ils ne voyaient pas bien où je voulais en venir, mais suivaient cela avec bienveillance : sans voir là de ma part aucune « apologie de l’homosexualité », mais plutôt curieux des péripéties ayant conduit à ma conversion, au vu de la ville et du milieu social dans lesquels j’ai grandi.
Autrement dit, l’échec de cette thèse ne sera mis au compte d’aucune « islamophobie » (du côté académique ou familial), ni d’aucune « homophobie » (du côté musulman). Juste une complexité dont il fallait rendre compte, qui ne se laissait pas cerner si facilement. Juste la difficulté de faire entériner par les institutions une connivence construite sur le terrain, sur la base de matériaux « homoérotiques » qui troublaient nécessairement mes auditeurs, notamment masculins. Chaque fois une partie du milieu académique bottait en touche, comme pour protéger sa propre honte. Mais j’acceptais cette règle du jeu, je prenais patience… Quand soudain, les Printemps Arabes font irruption !
Un printemps kidnappé par les sciences sociales (2011)
« C'est ridiculement confus, ridiculement injuste », dit Bateson (d’après Lewis Carroll) dans sa théologie du Bread-and-butterfly. De fait, ma recherche avait su se maintenir à l’interface de l’apprentissage et de l’évolution, ces deux niveaux de structure qui caractérisent nos existences (c’est toujours un peu la stratégie de l’ethnographie*…). À cette démarche, l’évènement des Printemps Arabe apporta un épilogue particulièrement cruel et paradoxal : d’une part, il livrait une explication rétrospective de toute l’intrigue, mais d’autre part, il instaurait des conditions telles que plus personne ne voudrait plus jamais la considérer…
Voyons d’abord les choses depuis mon « terrain ». Taez étant l’épicentre du mouvement au Yémen, j’étais fondé à faire un lien avec les péripéties vécues les années précédentes, en particulier l’épilogue si mystérieux de mon premier séjour (voir mon mémoire de maîtrise, surtout la section 14). Le Printemps Yéménite était déjà là, d’une certaine manière, dans l’emballement produit par ma démarche d’immersion, et par le souffle laïque qui la sous-tendait. Je rappelle que c’était l’été 2003, au plus fort de l’antagonisme Bush-Ben Laden, et en pleine opposition de la France à la guerre d’Irak… Une démarche de sciences sociales unitaire, anti-culturaliste et laïque, à laquelle les Yéménites n’étaient évidemment pas insensibles.
Mais l’investissement enthousiaste du langage des sciences sociales, et de sa grammaire, allait fatalement provoquer une répartition des rôles, entre les Yéménites qui se positionnaient comme « indigènes » et ceux qui se positionnaient comme « informateurs »* (termes consacrés dans la méthodologie). Plus l’intrigue du Za’îm prenait de l’ampleur, plus les défections de l’un à l’autre camp étaient dramatisées : comme si nous vivions une petite révolution en direct, projetée sur l’écran de ma subjectivité. Une révolution qui faisait peser sur Ziad la pression du « Régime » (en fait quelques notables locaux), mais dont la société environnante comprenait parfaitement les codes, le script, dont elle suivait le déroulement avec une sorte d’amusement.
Situation parfaitement incompréhensible pour moi à l’époque, par rapport aux réflexions et engagements qui m’avaient mené là, les cinq années précédentes, depuis mes premiers pas dans l’apprentissage de l’arabe. Situation violemment absurde, insoutenable en fait. La seule manière de retomber subjectivement sur mes pattes, c’était d’accepter un rapport sexuel, avec une personne n’ayant assisté à rien - en l’occurrence Waddah, ce cousin du Za’îm exilé à Sanaa depuis peu, auprès duquel j’allais passer les trois dernières semaines de mon séjour (octobre 2003). Donc un passage à l’acte sexuel, mais pas exactement sur le terrain, plutôt lié au premier arrachement et au premier passage à l’écriture. Et dont je sentais instinctivement qu’il autorisait un retour la tête haute, très paradoxalement.
Telle est l’intrigue ethnographique, formulée dans mon enquête ultérieure en termes « d’homoérotisme » : comment un acte homosexuel m’a-t-il permis de négocier une place ?
À ce mystère, ma conversion à l’islam n’apportait pas vraiment de réponse : tout au plus me permettait-elle de gérer la situation, de ne pas l’aggraver. Pour moi, c’est dans l’évènement historique du Printemps Yéménite que cette intrigue a vraiment trouvé sa résolution. Dans l’homosexualité subjective de l’enquêteur, une conscience collective sous-jacente s’était cristallisée, quant à la contribution de chacun à la corruption ambiante. Conscience d’une corruption moderniste fondamentale, irréductible à la corruption « tribalo-républicaine » (Sanaa), irréductible à la corruption « occidentale libérale » (Aden), plutôt une corruption propre à Taez, liée à l’image de soi dans la modernité. Autrement dit, la corruption du rapport aux sciences sociales.
L’islam était là, paradoxalement : dans cette conscience collective de la corruption, qui trouvait en ma présence une sorte d’écho. Il était dans cette sensation étrange que les Yéménites me regardaient, mais sans se focaliser sur mon propre regard, juste un peu au-delà. L’islam était dans ce témoignage, porté jusqu’au cœur de la complexité.
Je ne peux faire l’impasse sur cette histoire, si je veux dire comment je suis devenu musulman, comment j’ai eu cette chance, et accessoirement pour le rester. C’est ce que j’essayais de faire à travers ma thèse, au fond, dans le langage des sciences sociales : raconter les péripéties ayant mené à ma conversion. Un genre narratif dont les musulmans raffolent ordinairement, dont ils se délectent dans les moindres détails, sur le modèle d’histoires analogues vécues par les Compagnons.
Mais entre moi et les musulmans diplômés du Nord, l’évènement 2011 a creusé une frontière. Car dans les sciences sociales françaises, il fut l’origine d’un autre Printemps, adossé aux thèses décoloniales*. Je pense à cette génération de « jeunes universitaires » qui, face aux Printemps Arabes, prit le parti de renforcer les sciences sociales dans leurs certitudes, renforçant leur propre position discursive dans un régime épistémique* qui avait pourtant vocation à s’effondrer. Ce quiproquo historique était inévitable au fond. Mais notre pays continue d’en subir les conséquences jusqu’à ce jour, de même que les musulmans du Sud (Gaza, Yémen…). Et dans ces circonstances, forcément, notre histoire est frappée d’un tabou.
Jusqu’à ce jour, la Communauté peine à formuler une critique interne de cette subjectivité postcoloniale* diplômée*, portée à considérer comme « objectif national » sa propre réalisation disciplinaire, hors de toute considération pour la structure qui relieGB5. Contrairement aux Yéménites des années 2000, les musulmans actuels sont structurellement incapables de mettre en relation leur propre corruption avec le cours des évènements (voir mon texte islam muflis). Et ce comportement est le problème de notre monde, non pas le terrorisme et le populisme, qui en découlent en réalité. C’est ce qui fait qu’un jeune anthropologue, qui part à 23 ans pratiquer les sciences sociales laïques sur le terrain yéménite, et documente consciencieusement les effets de cette démarche, n’a toujours pas obtenu gain de cause vingt-deux ans plus tard.
Bien sûr en 2011, je n’étais pas armé pour énoncer ce constat. Le nez plongé dans ma thèse, écartelé entre une immersion strictement individuelle dans la société yéménite, et le monde académique parisien ou aixois, je marchais sur des œufs lorsqu’il était question de la communauté musulmane réelle. Et c’est finalement ce non-dit, surtout, qui a conduit mon doctorat dans l’impasse : ce silence, d’autant plus déstabilisant qu’il venait de ma communauté d’adoption, m’a empêché de mettre un point final à cette thèse, que beaucoup attendaient dans les milieux académiques.
Alhamdulillah, il n’y a évidemment pas lieu de le regretter, comme si le cours de l’histoire yéménite en eut été différent. Mais sur cette séquence historique, dont nous peinons encore à nous extraire, cette petite histoire apporte un autre éclairage - d’où ma reprise d’écriture.
Je ne crois pas qu’il faille compter sur l’anthropologie pour sauver le monde, ni même sur les sciences sociales, qu’elles soient « symétriques », « décoloniales » ou « écosystémiques ». Je crois par contre que notre monde se portera mieux quand les musulmans diplômés du Nord, au lieu de se cacher derrière l’« anthropologie de l’islam »*, décideront de quelle anthropologie ils ont besoin eux, en tant que musulmans. C’est peu ou prou à cette question que je tente de répondre ici.