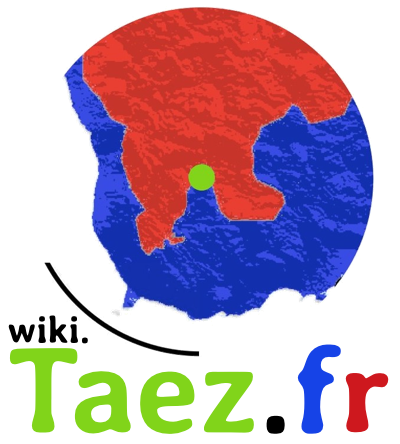Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Christoph
Ami allemand rencontré à l’association homosexuelle de la Cité Universitaire Internationale de Paris au printemps 2005 (rédaction de mon DEA), auquel je suis resté lié jusqu’à l’automne 2006 (début seconde année de thèse). Période qui correspond à la mise en place de ma problématique, de certains leitmotivs qui caractériseront mon analyse pour longtemps.
J’ajoute cette page au dossier personnes le 17 avril 2025 : pas pour raconter cette relation, mais pour trouver son articulation formelle à tout le reste.
(Cette relation est en fait déjà évoquée sur ce wiki, dans ma discussion de 2011 avec Ludovic-Mohammed Zahed).
L’objectivité du corps dans sa relation aux choses du monde
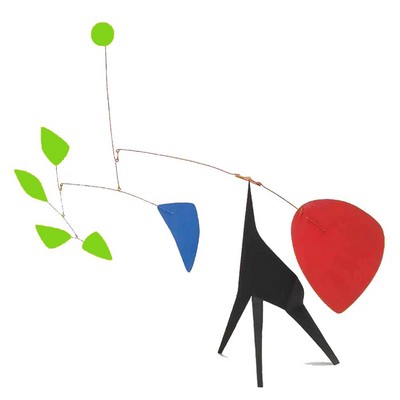 Alexander Calder, Lone Zig-Zag (1966).
Alexander Calder, Lone Zig-Zag (1966).
Dans l’histoire que je tente de raconter ici (section Comprendre), Christoph est le nom d’une étape logiquement nécessaire. Une étape indispensable pour construire la personne qui retourne à Taez en 2006, qui relève le défi de l’homoérotisme* et fait sortir Ziad de ses gonds.1)
Quand je pense à Christoph aujourd’hui, je pense en fait surtout à mon propre corps, sous le regard de la sociologie. Et je ne parle pas là d’un souvenir sensuel, plutôt de cette expérience mentale* bien particulière, qui m’encombre encore aujourd’hui dans l’accès au Texte2) : l’objectivité du corps dans sa relation aux choses du monde (= vision d'un monde sans Dieu).
Christoph et moi parlions la même langue (il parlait très bien français), je partageais avec lui sans difficulté mes analyses, y compris dans ce qu’elles comportaient de ressenti. Christoph et moi parlions sur la base d’un même corps - contrairement à mon expérience avec Waddah d’une part, avec ma petite amie d’autre part - soit la séquence de rédaction de ma maîtrise (Octobre 2003/Juin 2004) : ma subjectivité s’affirmait alors contre le corps de l’autre, pour lui arracher un secret entr’aperçu là-bas. Mais là je construisais un projet de thèse, donc c’était tout autre chose.
En phase avec l'équipe pédagogique de mon DEA, il s’agissait de rompre avec l’anthropologie culturaliste*, de restituer le terrain yéménite aux sciences sociales généralistes. Je cherchais une manière d’y parvenir, en lisant des sciences sociales dans tous les sens, dans une liberté intellectuelle totale, devant un horizon totalement ouvert. Et Christoph était le confident idéal dans cette quête, lui qui ne connaissait rien au monde arabe, qui était dénué de tout a priori idéologique, seulement mû par une curiosité, un désir un peu fasciné.
Une résilience
Sans cette relation, difficile de comprendre la différence entre mes deuxième et troisième séjours :
• 2004 : l’ethnographe tétanisé par le retour sur le terrain, constamment sur la défensive ou perdu dans ses pensées, donc incapable de nouer la moindre relation nouvelle, et qui finit par enquêter sur les plus misérables, faute d’avoir pu s’extraire du caniveau (cf article « Les hommes de peine dans l'espace urbain »).
• 2006 : l’ethnographe sur le terrain de l’humour et de la boutade homoérotique, qui déplace progressivement l’échange de ses propres contradictions vers celles de ses interlocuteurs, et acquiert par là une perception de l’espace social bien plus incarnée, consciente des défis posés à l’apprentissage individuel (cf résumé de 2008).
L’évolution n’est pas concevable sans cette expérience de fraternité homosexuelle - en fait de fraternité tout court, inédite dans ma vie à l’époque. Face à la fraternité yéménite devenue inaccessible, qui s’était refermée comme une huître à peine entraperçue (septembre 2003), j’avais mobilisé toutes les ressources mentales* de mon propre environnement, ressources intellectuelles et de socialisation, pour relever le défi par anticipation.
L'Europe et l'Islam
L’Europe* fonctionne toujours comme ça, dans sa longue histoire co-évolutive* avec l’Islam. Moi bien sûr, je n’avais pas conscience de préparer une croisade : je me débattais avec mes angoisses existentielles - surtout cette année 2005… - sans avoir aucune idée où cette histoire pouvait bien mener. L’altérité islamique était totalement invisible à ce stade (c'est ma réponse aux thèses « décoloniales »*) : son rôle structurant n’affleurait même pas à ma conscience, et je ne pouvais pas imaginer me convertir un jour. N’empêche que l’Europe se débrouille toujours, d’un point de vue systémique et historique global, pour construire des fraternités partielles, fondées sur des codes de sociabilité autonomes, orientées vers la maîtrise pratique d’un arsenal - le cas typique étant l’intuition* des physiciens. Mon « intuition » de sociologue*, je l’ai largement construite dans ma relation avec Christoph, et plus largement, dans les rapports de sociabilité étudiante et/ou homosexuelle qui constituaient ma vie dans cette période - au moins autant que dans mes interactions sur le terrain.
Cette relation-là, cependant, m’a aussi confronté aux limites de la sociologie : limites à ce que je pouvais partager avec lui, jusqu’à quel point pouvais-je espérer qu’il me suive, dans l’appréhension d’un paysage distant. À l’automne 2006, peu après mon retour de six mois à Taez, j’impose à Christoph un régime d’abstinence, alors qu’il est venu me voir exprès à Marseille (c’est le « coup de pute » auquel je fais référence dans l’entretien, très bien justifié dans l’extrait suivant). À l’époque je ne fais pas ça pour l’islam : je cherche à conserver quelque chose que j’ai entrevu, étroitement lié à l’homosexualité (dans mon point de vue de cette époque), et que j’aimerais pouvoir partager avec lui. Ça ne marche pas : à la fin du séjour Christoph rentre chez lui, en me prenant sans doute un peu pour un « pervers narcissique », et notre relation s’arrête à peu près là.
Enfermer ce corps
Face au texte coranique, le même problème se pose : lorsqu’il s’agit de fixer des impressions de lecture, des intuitions fugaces, dans l’espoir de soutenir la mémorisation. Ça ne marche simplement pas, dès que le geste s’enracine dans le Soi dualiste* (« l’objectivité du corps dans sa relation aux choses du monde ») : le texte se dérobe, il ne se laisse pas piéger.
J’ouvre cette page pour me rappeler ce corps-là, avec lequel il me faut rompre. Si j’arrive à l’enfermer dans ce wiki, ce sera peut-être la meilleure manière.
Ce nom de Christoph ne vous dira pas grand-chose, si ce n’est le nom d’un amant européen : cela suffira à lever bien des fantasmes quant à ma supposée homosexualité sur le terrain, avec les Yéménites. Fantasmes que j’ai constamment entretenus dans l’écriture de ce wiki, en jonglant avec Ziad, Ammar et Waddah, Yazid, Nabil et tous les autres. Mais l’écriture par hyperliens a cette magie des mobiles de Calder : l’ajout d’une seule page entraîne parfois une réorganisation de l’ensemble, par le simple jeu de la gravité. Ce corps finira bien par apparaître, dans l’esprit du lecteur aussi.