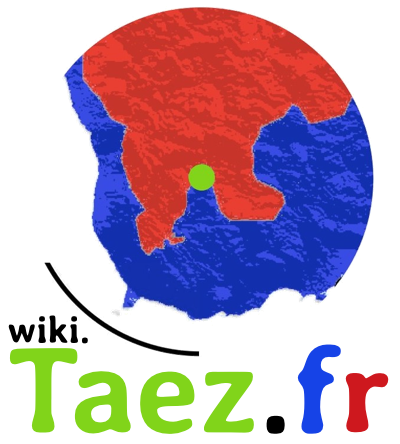Table des matières
Tradition et consensus au prisme de l’ethnographie réflexive
(à propos de l’expression ahl al-sunna wal-jamâ’a)

11-13 juin 2023
1. Une conversion ethnographique
J’ai atterri quelque part, dans une ville que j’avais vaguement choisi sans la connaître. J’ai connu les gens, passé de longues heures jour après jour à remplir mes carnets. Au fil des textes élaborés (mémoires, articles), de mes allers-retours successifs, j’ai construit un terrain. Dès ma deuxième année de thèse, j’avais franchi le cap des douze mois de présence cumulée, cap symbolique dans la corporation des anthropologues. Pourtant je suis reparti encore : pas pour récolter de nouveaux matériaux, non : parce que je n’arrivais pas à concevoir mon plan. J’avais besoin d’être là-bas, de sentir la présence des Yéménites derrière mon dos, comme s’ils devaient lire par dessus mon épaule…
Or au cours de cette année passée en France, la situation de mes interlocuteurs s’était brusquement détériorée : déboires professionnels, impuissance sexuelle, accidents de voiture, mort, maladie psychiatrique. Ceux-là venaient d’un milieu à problèmes, je le savais déjà… Mais là, mon modèle était dépassé. J’avais un pressentiment, sans pouvoir l’expliquer encore : ces désordres n’étaient-ils pas liés au regard que je portais sur eux ? L’enquête aurait-elle pu, d’une manière ou d’une autre, leur jeter le mauvais œil ?… Pour raconter cette histoire, le présent anthropologique n’était plus approprié. Alors je me suis converti à l’islam.
Dans le cadre de cette conversion « sur le terrain », il n’y a pas eu de cérémonie. Dans ce lieu précis de Hawdh al-Ashraf, où j’usais mes pantalons depuis quatre ans, j’ai juste commencé à faire la prière avec les autres et à fréquenter la mosquée. Je me suis déclaré musulman au visage de mes interlocuteurs, tandis que devant mon ordinateur j’explorais des raisonnements nouveaux - des raisonnements de type cybernétique*, expliquant pourquoi je (Mansour) devais nécessairement me convertir. Ma conversion en elle-même est restée complètement hors-champs. Elle s’est jouée quelque part, dans les limbes de mon intime conviction. Je n’ai eu qu’à en informer d’une part les interlocuteurs de mon enquête, d’autre part mes interlocuteurs académiques. Mais fondamentalement, le geste ne les concernait pas.
Pourquoi je me comportais de la sorte, je ne savais pas bien l’expliquer. Tout au plus, je pouvais pointer des circonstances : tel et tel incident, dont je ne parlais pas du tout à l’époque - plutôt telle et telle frustration antérieure, bien localisée sur mon « terrain ». J’avais aussi conscience de protéger certaines idées : une certaine conception des sciences sociales, de la rencontre ethnographique, voire en fait de la laïcité ; idées relativement mal définies, indissociables d’appareils théoriques et méthodologiques bien particuliers. Des circonstances, des idées, mais aucune proposition théorique, ni aucun diagnostic général quant à l’ordre postcolonial* (voir glossaire). Pourtant mon geste était parfaitement clair : je me suis converti à l’islam tout en refusant à la société locale le statut de « communauté », telle qu’instituée par mon « terrain ». D’où l’absence de cérémonie.
Sans que je l’assume encore vraiment à l’époque, ce geste était déjà une prise de position quant à une certaine définition de l’islam, comme communauté « de la Tradition et du Consensus ». En tant qu’anthropologue, je n’étais pas venu chercher une tradition : j’abordais le terrain dans une perspective de sciences sociales généralistes, assez sceptique quant à la notion de culture. J’avais choisi Taez, la ville des diplômés, dans l’idée de développer des outils intellectuels communs. Donc je n’étais pas plus venu chercher le consensus, mais l’exercice de la critique et du doute méthodique, que j’espérais pratiquer avec mes interlocuteurs. Cette approche fondamentalement laïque laissait la religion à l’écart, et c’est ce qui m’a permis de me convertir à un moment t de ma recherche, à l’heure du retrait.
En tant que croyant, c’est bien sûr différent : je crois en l’existence d’une Tradition, je crois en l’existence d’un consensus, et je crois à cette définition de l’islam comme « Communauté de la Tradition et du Consensus ». À vrai dire, j’ai l’intime conviction d’y appartenir, quoi qu’au premier abord cela ne semble pas évident.
2. L’impossible cérémonie
Plus de quinze années ont passé depuis septembre 2007, et cette absence de cérémonie n’a jamais été « réparée ». En interne, je n’ai jamais su trouver les mots pour partager mon histoire dans la Communauté (Umma). En externe, cette thèse n’a finalement jamais été soutenue - et ce n’est pas faute d’intérêt du monde académique, puisque j’avais eu le Prix Michel Seurat en 2009. C’est plutôt que la communauté en France (la jâliya maghrébine, sénégalaise etc.) n’a jamais voulu comprendre cette pudeur qui me séparait de mon terrain Yéménite. Faute de pouvoir dire mon histoire, je me suis retrouvé en échec professionnel, et j’ai dû retarder mon retour là-bas ; entre temps la guerre avait commencé…
L’absence de cérémonie n’a jamais été « réparée », et je ne dis pas ça pour moi bien sûr : l’enjeu n’est pas de me faire plaisir, ou de me convaincre que je suis bel et bien musulman ; l’enjeu est de rendre à ceux qui ont porté témoignage. Car quand j’ai atterri quelque part, j’ai bien atterri chez des gens particuliers ! Pendant toute cette période en amont de ma conversion où j’ai construit ma recherche, où j’ai rempli mes carnets, m’accrochant à ce que j’arrivais à comprendre au fil d'allers-retours passablement déstabilisants ; pendant ces quatre années où ma tête était plongée exclusivement dans les sciences sociales, certaines personnes n’ont jamais cessé de voir plus loin, se comportant avec moi dans une dignité et une générosité constantes… Si ces personnes ne m’avaient suivi du regard, comment le regard d’Allah m’aurait-il rattrapé ?
Or à aucun moment l’idée n’a pu s’imposer que la réception de cette histoire, dans ma langue maternelle où elle s’est écrite, relevait d’une obligation collective pour la Communauté (fard kifaya). Inlassablement, j’ai été confronté au silence des musulmans diplômés, et à l’incompréhension des musulmans ordinaires : « Dans chaque maison, il y a des toilettes… ». Phrase blessante, rédhibitoire, qui résume à elle seule l’insurmontable malentendu.
Au cours de ces quinze années, le Moyen-Orient et la France ont été frappés par de grandes tragédies. Certes, en nombre et en proportions différentes - mais elles ont en commun que j’en ai été le témoin impuissant, et que dans ces conditions j’ai développé sur elles un regard bien particulier. Je crois que cette petite histoire porte en-elle une intuition utile pour notre temps : pour reconstruire la relation entre sciences sociales et islam, après les tragédies de la décennie écoulée - pour frayer un nouveau chemin (texte « programmatique », adressé aux sciences sociales).
3. Saeed Fodeh et le Big Bang monothéiste
Concernant la Communauté, le versant « théologique » du problème, j’ai traduit ci-dessous les explications du professeur jordanien Saeed Fodeh sur l’expression « Gens de la Tradition et du Consensus » (ahl al-sunna wal-jamâ’a) :
⇒ « Gens de la Tradition et du Consensus » (Saeed Fodeh)
(Page spécifique avec la transcription découpée en sections, pour saisir la trame de l'argument)
J’ai traduit ce cours en fait pour deux raisons.
D’abord, Fodeh explique très bien ce qui a pu m’attirer intellectuellement dans l’islam, et plus spécifiquement encore dans l’orthodoxie sunnite, en tant que jeune chercheur formé en sciences sociales* généralistes, sensible à la problématique de leur unité. On sera attentif à la manière dont Fodeh, au fil de l’exposé, réintroduit progressivement la notion de haqq, le Vrai, qui est l’un des noms d’Allah. Fodeh parle de ahl al-haqq, les Gens du Vrai, il parle d’iltizâm bil-haqq, l’engagement dans le Vrai. Il y a là tous les ingrédients de la rencontre ethnographique*, telle qu’au départ j’ai pu l’imaginer.
Quoi que passablement sublimée, cette conception m’a bien mené quelque part : la sublimation a bel et bien fait lien. Dans cette société, j’ai su percevoir une énergie qui couvait, évidemment liée au Printemps Yéménite sur le point de faire irruption, mais une énergie qui prenait racine plus loin : dans une sorte de Big Bang monothéiste, dont le postulat était logiquement nécessaire à l’élucidation de mon expérience ethnographique.
Tout le problème cependant, une fois évacuée l’erreur du matérialisme historique, est de situer ce Big Bang : d’où la centralité de Jésus dans les voyages de Ziad (section explorer), parallèlement à mon propre enracinement dans la Communauté de Mohammedﷺ. Entre Ziad et moi, le contentieux est irréductible, comme entre les différentes communautés religieuses dont la matrice monothéiste* a toujours été constituée -【لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا】(Coran 5:48). Ce qui caractérise notre époque, c’est moins l’affrontement des traditions religieuses à l’échelle mondiale, que l’incapacité chronique de la laïcité d’inspiration française à faire médiation, à trouver le chemin de la neutralité (effet Villepin). D’où qu’entre Ziad et moi, le contentieux est insoluble : non parce que les Yéménites au Hawdh al-Ashraf n’auraient pas compris notre histoire, non parce que Ziad y serait persécuté ; plutôt parce qu’ici, dans l’opulence occidentale, la société française pratique une laïcité pour soi, pendant au rationalisme pour soi de l’islam communautaire.
Là est le drame dont je fais l’expérience depuis quinze ans. Car bien sûr, les musulmans diplômés seraient mes interlocuteurs naturels : les plus à même de recevoir notre histoire, d’en suivre les méandres argumentatifs, d’en distinguer enfin la logique générale. Malheureusement, ceux-là évoluent en fait dans une parfaite ignorance des contraintes, des dilemmes, des paradoxes parfois tragiques dont nous faisons l’expérience. Or le cours de Saeed Fodeh est exemplaire de cela aussi : le décalage complet d’un argumentaire acharite - relatif à Abu Al-Hasan al-ʾAshʿarī (873-935) - c’est-à-dire antérieur à l’émergence du rationalisme* européen, par rapport aux dilemmes de notre modernité*, à leur complexité spécifique.
En tant qu’anthropologue-musulman*, converti à l’islam sur un terrain ethnographique, j’ai toujours été renvoyé à l’ambiguïté de mon geste. N’ayant jamais vraiment renoncé aux sciences sociales malgré l’échec de ma thèse, n’étais-je pas plutôt un crypto-chrétien ? - comme d’ailleurs le pensait Ziad (jusque très récemment). Derrière mon attachement au raisonnement, à la « démonstration du Vrai » (istidlâl al-haqq, pour reprendre les termes qu’utilise Fodeh), n’étais-je pas au fond constitué surtout par une expérience chrétienne, qui me laisserait toujours en marge de ma Communauté ? Étais-je bien sûr, en d’autres termes, de situer le Big Bang au bon endroit ?
Si j’ai pu dépasser ce paradoxe, peu à peu, c’est par la contemplation de l’Histoire. À mes yeux, la modernité européenne ressemble à une centrale nucléaire - un programme nucléaire civil… - qui s’évertue à maintenir ce Big Bang sous contrôle, par un débrayage bien conçu du réacteur monothéiste (voir Frayer vers l’Islam). Pas juste l’islam donc : c’est l’intuition monothéiste qu’il fallait domestiquer, l’histoire des idées ne pouvait se concevoir autrement. La Science n’a pas attendu l’invention de la cybernétique*, au milieu du XXe siècle, pour découvrir les vertus de la rétroaction. D’où la pertinence, qu’on le veuille ou non, d’un Ibn Taymiyya (1263-1328), puis d’un Mohammed Ben Abdelwahhab (1703-1792). Le rationalisme d’un Saeed Fodeh est-il seulement capable d’envisager l’idée de rétroaction, d’en apercevoir les conséquences dernières pour notre temps ? La tradition acharite les prépare-t-elle à cela ? Honnêtement je n’en sais rien. Je soupçonne parfois qu’ils ne se posent pas la question.