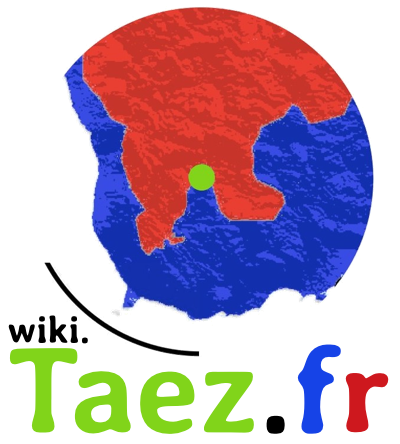Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Tawhid et anthropologie
Propositions théoriques en prolongement de mon texte : Tawhîd et intersexuation (6-21 février 2024)
1. La Caravelle et le musulman
Le propre de l’anthropologue est de tomber du ciel, chez des gens qui ne l’ont pas choisi. Il n’y a pas d’autre anthropologie possible que celle qui découle de l’histoire intellectuelle européenne, du rapport au monde de l’Europe, né avec les « Grandes Découvertes » du XVe siècle. La Caravelle s’approche de la côte : l’anthropologue débarque, il tente de s’entendre avec les natifs, puis repart ; la Caravelle en tire quelques enseignements, pour que cela se passe mieux la prochaine fois…
Dans toute recherche anthropologique, l’insertion dans la vie sociale locale repose sur une alliance d’enquête* : l’engagement de facto d’un certain nombre de personnes (par exemple un groupe familial), embarquées dans l’enquête malgré elles, et donc prêtes à donner encore un peu afin qu’elle aboutisse. Au retour, on commence par expliciter l’alliance d’enquête, comprendre le système de places local, pour seulement ensuite reconsidérer les matériaux. C’est la pierre angulaire de la méthode réflexive* en anthropologie. Empêchez l’explicitation de l’alliance d’enquête, et vous empêchez la thèse d’aboutir. La réalité qu’elle documente tombera alors dans l’oubli, dans la non-existence, possiblement dans la guerre. À moins que nous-mêmes ayons cessé entre-temps d’exister…
[Reprise de la conclusion]
Entre 2007 et 2013, j’ai tenté sans relâche de sauver mon enquête au Yémen. Et je précise à nouveau qu’à l’époque, il n’était fait mention nulle part d’octobre 2003 : simplement de la « folie » de Ziad, le héros de mon premier mémoire, autour de laquelle j’avais recentré ma thèse au moment de la rédaction.1) La thématique de « l’homoérotisme » organisait mon analyse, mais j’en défendais une conception interactionniste et réflexive, réduite à l’hypothèse minimum : l’homoérotisme* au sens des perceptions d’homosexualité dans l’œil de l’observateur sociologue.
Seulement pour faire preuve de pudeur, il faut être au moins deux. Il faut un locuteur qui contourne l’obstacle, mais aussi quelqu’un en face qui consente à ce contournement. Alors seulement, il devient possible de taire ce qui doit être tû. Je ne peux avoir de pudeur si mon interlocuteur n’en a pas lui-même (s’il revient sans cesse sur l’obstacle, ignorant les signes posés), ou au contraire s’il en a trop (s’il refuse le chemin proposé, préférant déserter le terrain tout entier). La pudeur est un travail partagé, qui implique en ce sens une dimension communautaire. Il faut que se recoupent un minimum la communauté des sciences sociales2) et les autres communautés, notamment religieuses.
Or ce qu’on observe aujourd’hui avec l’islam, c’est précisément l’inverse : l’invention artefactuelle d’une frontière, réactivant perpétuellement le spectre de la Caravelle, ce qui est un non-sens historique. Rappelons que les Grandes Découvertes du XVe siècle avaient pour motivation première d’accéder à l’or par contournement des voies commerciales dominées par les musulmans. C’est là leur vérité historique et anthropologique, il n’a jamais été question d’aborder en terres musulmanes - même si le contentieux colonial alimente aujourd’hui des reconstructions fictionnelles : la scène de « bons sauvages » musulmans sur leur plage, accueillant la Caravelle avec des corbeilles de fruits… L’anthropologie de l’islam est un mensonge.3)
Mais ce mensonge repose sur une expérience inhérente à l’ère postcoloniale*, qui est l’inverse de la Caravelle : « l’anthropologie de l’islam » est celle du musulman qui a trouvé sa place en France, et qui ne veut pas qu’on l’embête quand il évoque le quartier de son enfance. Face à l’histoire que je rapporte, le diplômé musulman développe une répulsion « naturelle », qu’il considère éminemment légitime, parce que cette répulsion est l’islam de son point de vue. Or en réalité, il y a là un phénomène éminemment intellectuel, ancré dans une manière bien particulière d’aborder le monde et son histoire, indissociable de certains partis pris théologiques, épistémologiques et existentiels (il n’y a pas lieu de les développer ici, c’est l’objet de ce site dans son ensemble).
Ce phénomène ne concerne donc pas seulement l’anthropologie institutionnelle, et pas seulement les sciences sociales, mais l’ensemble des secteurs administratifs et professionnels (la justice, l’enseignement, le travail social…). À tous les niveaux, les musulmans diplômés ont acquis une capacité à parler anthropologiquement de leur « culture », c’est-à-dire en fait de leur nafs, de leur petite personne. Or dans l’anthropologie elle-même, aucune proposition théorique sérieuse ne répond aujourd’hui à ce phénomène.
Fatalement, le diplômé musulman est tenté de franchir un pas supplémentaire4), en confondant cette « anthropologie de l’islam » avec l’islam lui-même. Et c’est là qu’il devient utile de parler un peu plus sérieusement d’anthropologie et d’unicité.
2. Le dévoiement de l’option culturaliste
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, l’option culturaliste n’est pas l’option théorique majoritaire en anthropologie. Elle l’est dans l’anthropologie américaine, à cause du contact avec les peuples natifs du continent. Elle l’a été aussi en France dans l’immédiat après-guerre : l’anthropologie structuraliste des années 1950 et 1960, dont Claude Levi-Strauss était le chef de file, était fondamentalement culturaliste ; elle recherchait la cohérence des phénomènes à l’échelle de l’entité culturelle, et concevait ainsi son objet. Pour autant, il est de notoriété publique que Levi-Strauss avait un problème avec l’islam, un problème intellectuel : il ne saisissait pas la raison d’être du « mariage arabe », alliance préférentielle avec la cousine paternelle (fille du frère du père), observable dans de nombreuses cultures musulmanes.
Les plus belles études structuralistes sur la zone sont peut-être les Études kabyles de Pierre Bourdieu, écrites en hommage à Levi-Strauss, mais qui tiraient l’étude de l’honneur* vers une conception toute autre des sciences sociales. En 1972, les Études kabyles sont republiées en préambule à l’Esquisse d’une théorie de la pratique, ce n’est pas un hasard. Ce que recherchera l’anthropologie par la suite, c’est la cohérence du geste ethnographique* : la cohérence d’une écriture située.
À la fin de mon premier séjour, dans les circonstances ici relatées, la méthode ethnographique trouve son aboutissement, se réalise, et c’est dans cette expérience que se révèle à moi la possibilité du tawhîd : une cohérence du geste et de la parole qui est l’indice de la vérité, sans ambiguïté possible. L’ambiguïté viendra ensuite : le travail de rédaction enfermera cette vérité dans une perspective sociologique, dont je m’échapperai sitôt le mémoire déposé. Pour retourner sur le terrain, je me reconnecte alors à ma « vraie nature » (fitra), que j’appelle alors « homosexualité ». Mais l’intersexuation n’est pas une caractéristique individuelle, elle est la condition commune de l’Humanité, qui traverse toutes les situations sociales.
L’Unicité dans la conception musulmane sunnite est très souvent mal comprise, à l’extérieur mais parfois aussi à l’intérieur de la Communauté. On la comprend comme calibrage sur un modèle unique de comportement (l’orthopraxie de la sunna) : l’espoir de retrouver une illusoire authenticité culturelle, en découpant tout ce qui dépasse. Or ce qui est célébré dans la sunna, ce n’est pas l’unité d’une culture, plutôt une cohérence du geste et de la parole, dont l’islam sunnite postule qu’elle est ailleurs inégalée.
Dans la recherche de cette cohérence, il est inconcevable de faire abstraction des traditions pré-existantes du monothéisme, auxquelles l’islam se réfère par construction. Pour témoigner de ce que le geste et la parole ne furent jamais aussi cohérents que dans l’Arabie du VIIe siècle, il faut d’abord que soient cohérents le geste et la parole du musulman contemporain, et d’abord dans la désignation de l’islam lui-même. Porter la barbe et le qamis, accompagnés du bon comportement, est une option cohérente. Il est également cohérent de témoigner par un comportement intellectuel exemplaire, au sein des institutions héritées de l’histoire monothéiste : le port de la barbe et du qamis est dans ce cas optionnel, l’essentiel étant de pointer correctement l’islam dans le langage propre de l’institution. Or ce qui se passe avec « l’anthropologie de l’islam », c’est que le geste et la parole pointent des directions différentes : elles piègent l’interlocuteur dans une double contrainte*, en identifiant l’islam dans un non-lieu.
Plus grave encore, beaucoup de musulmans diplômés semblent s’être accoutumés à cette dissonance, qu’ils identifient maintenant comme la religion elle-même. Voici un signe qui ne trompe pas.
3. La nouvelle « conversion » des musulmans diplômés
Au sein des communautés musulmanes occidentales, on entend souvent remettre en cause la condition spécifique du converti : comme quoi en fait, nous le serions tous un peu à cause des années 1970, à cause de l’état d’incroyance généralisée (nous dit-on) qui régnait alors dans les sociétés musulmanes. C’est dit avec de bonnes intentions, comme une preuve d’ouverture à notre égard - sous-entendu : nous aussi nous sommes impurs, à cause de nos parents… Voilà le type de discours à partir duquel beaucoup de musulmans occidentaux s’efforcent de faire communauté. Et quand je pose mon poulet rôti sur la table, tout le monde déguerpit…
En réalité, ce discours généralise abusivement une condition spécifique : celle des musulmans diplômés issus de parents eux-mêmes diplômés, dans les premières décennies après les Indépendances nationales. Ceux-là effectivement ont souvent dû se construire contre des parents athées - mais au sein d’un système éducatif national, culturellement musulman. Se présenter soi-même comme converti dans ces conditions, c’est confesser malgré soi un échec intellectuel, individuel et collectif : la condition de diplômé était censée donner les moyens de s’élever, de se situer dans l’histoire et le temps ; manifestement le diplôme n’offre plus rien de cela, seulement la maîtrise d’un savoir technique particulier. À travers sa « conversion », le musulman diplômé affirme l’existence d’une autre vérité, à laquelle il se rattache « en wifi », sans mémoire précise du cheminement de cet héritage.
Je mets des guillemets au mot « conversion », pas pour suggérer la tiédeur ou la fausseté de l’engagement religieux ; même pas pour contester l’idée d’une fausse conscience des sociétés occidentales, dont il faut d’urgence nous extraire. Mais une conversion, cela suppose une transition entre deux points A et B clairement définis : du rationalisme athée vers le christianisme, ou encore du christianisme vers l’islam. Le fait de devenir pratiquant, d’activer une tradition héritée que l’on portait jusque là plus passivement, cela ne relève pas de la conversion. Ou alors, on utilise le mot « conversion » au sens du protestantisme : je vis dans une société chrétienne, mais pas assez à mes yeux, et j’entends remédier à cette situation individuellement, sur la base d’une conception individuelle de la prédestination.
Que des musulmans utilisent le mot « conversion » dans le sens du protestantisme, cela n’est pas anodin. Et il n’y a rien d’étonnant à la réussite du processus en apparence, la formation de communautés nouvelles, par agrégation de ces conversions « wifi ». Cet effacement de l’Histoire a un nom : cette situation où une autre tradition religieuse se coule dans les conceptions théologiques du protestantisme, afin de négocier l’existence d’un projet national ou communautaire, cela s’appelle le sionisme. Bien sûr, ce sionisme musulman n’apparaît pas comme tel : il reste sous le voile des apparences tissées jour après jour par les sciences sociales, avec la complicité active de nombreux musulmans diplômés (c’est ce processus que j’appelle « anthropologie de l’islam »*). Mais Allah est clairvoyant : Il connaît les petites démissions ordinaires qui, depuis 2011, ont produit la situation géopolitique où nous nous trouvons aujourd’hui.
(Mes textes sur Gaza, décembre 2023).
(Interférences de l'Incarnation)
Octobre 2003 est la clé de voûte de tout mon travail : au sens où chacun des textes que j’ai produit depuis vingt ans, visait d’une manière ou d’une autre à poser cette dernière pierre, chaque échec appelant en réponse une surenchère de moyens, un système de voûte un peu plus complexe.
Non pas qu’il y aurait eu là un « traumatisme » qu’il fallait dénouer : simplement parce qu’il était l’instant du premier passage à l’écriture, et que ma recherche a toujours cherché à explorer les conditions de possibilité de l’observation. D’ailleurs en amont déjà, dès mon arrivée sur le terrain et mon alliance avec Ziad, l’idée était de nous mettre d’accord sur les prémisses. Le mystère de cette configuration ne réside donc pas dans son caractère sexuel, au contraire totalement transparent : elle découle de processus épistémologiques complexes, dont la confrontation à la sexualité est seulement l’une des manifestations possibles. Et à mes yeux, sa formulation ultime ne peut résider que dans l’ordre théologique : dans les conceptions différentes de l’incarnation* qui caractérisent chacune des traditions monothéistes ; dans leurs tensions, leurs décalages et interférences, qui ont été le creuset de la différenciation progressive entre Islam et Europe*, et d’autres traditions encore.
(À l’origine de toute cette histoire, il y a les circonstances de mes premiers pas dans l’apprentissage de l’arabe, lors de l’année universitaire 1998-1999, et la rencontre de deux élèves en classe préparatoire : l’un français et physicien dans l’âme, l’autre tunisien de profil plutôt matheux, qui ne goûtait guère la physique, ce qui produisait chez moi un étonnement toujours renouvelé. Il y avait là déjà un décalage d’incarnation épistémique.)