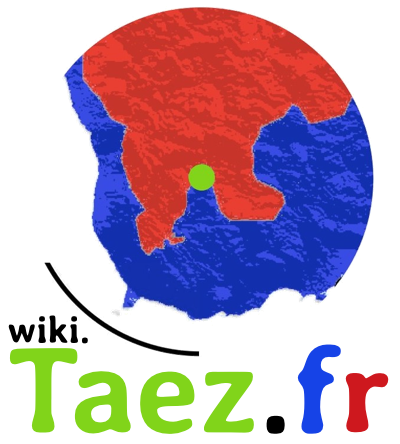Table des matières
Explications sur le qat et la société yéménite
Rédigé d'un trait le 2 avril 2025, en vue d'une traduction immédiate (assistée par l'IA).
Un sketch sur Facebook
- « J'ai pas très bien compris 😂 »
Oui, même moi je comprends rien, le gamin mâche ses mots, forcément…
Bon je t’explique un peu, au moins des éléments de contexte - comme ça je fais un peu d’anthropo !
Déjà un gamin de cet âge, normalement il ne mâche pas le qat, ou alors on lui donne quelques feuilles et il mâche ça silencieusement près de la porte. Là au contraire, le père l’a mis à sa droite, en tête du diwan à la place d’honneur. Par contraste à sa gauche, tu as ses fils aînés, amis ordinaires ou clients (on comprend pas très bien, mais le père dit : « Voilà tu as un frère ici, et trente frères là, ça fait trente et un frères »). Bref le père fait comme si le petit dernier était son ami intime, qu’il veut honorer en tant qu’égal.
Et voilà que le gamin passe par toutes les phases habituelles, de prise de tête et d’angoisses existentielles, liées à l’effet du qat. D’abord il dit : « Je suis tout seul, depuis la mort de mon père… » - alors que son père est à côté, s’exaspèrent les autres, mais le père dit : « Laissez-le s’exprimer ». Alors il lui vient l’idée de se lancer dans un projet (mashru’) : il veut vendre des chips. Après il parle de « chouppi » (aussi un truc de gamin, je sais pas trop ce que c’est). Et finalement il éclate : « Je veux me marier ! » - alors qu’il n’est même pas pubère…
Voilà pour l’essentiel. Mais sinon moi non plus, j’ai pas compris la moitié des blagues.
Le qat et l’État-nation
Tu as ici l’autre versant de la société yéménite, par rapport aux guerriers qui défendent la Palestine, l’image projetée à l’extérieur. La société yéménite ordinaire, c’est des gens comme ça, que la modernité rend un peu fou, qui ont l’impression d’être en capacité, et qui en même temps se découragent très vite.
Le qat est très lié à cette expérience. À la base il était seulement consommé par les élites, les juges, les travailleurs intellectuels (ceux dont les spéculations sont mises à l’épreuve du papier). Mais le qat s’est généralisé avec le développement de l’État-Nation : l’individuation des sujets modernes, qui doivent tous « devenir » quelque chose. Du coup le pays ne produit que du qat, et toute la population engouffre ses revenus dans cette activité, purement somptuaire. Mais c’est la seule manière d’exister socialement, pour l’immense majorité des hommes (et aussi beaucoup de femmes).
Moi franchement je déteste ça. Je hais le qat, vraiment, parce qu’il est pour moi indissociable de ma jâhiliyya°.
Une situation ethnographique
Quand je suis arrivé au Yémen, c’était pour faire du terrain, pour vivre avec les Yéménites et les étudier en faisant comme eux (ce qu’on appelle « l’observation participante »*). Donc je qatais presque tous les jours : dans les premières heures on discutait de quantité de choses, puis chacun se refermait sur lui-même en fin d’après-midi (ce qu’ils appellent « l’heure de Salomon », al-sâ’a al-sulaymaniyya). Les Yéménites à côté de moi se débattaient dans leurs problèmes existentiels, et moi je me débattais dans mon problème théorique : Quelle analyse produire? Comment modéliser la société ?
Et bien sûr ça faisait un lien entre nous, ou plutôt des liens, à différents niveaux :
- en tant que sociologue c’était mon objet de recherche de comprendre les difficultés des Yéménites, d’analyser leurs angoisses existentielles ;
- par ailleurs, la réussite de ma thèse était bel et bien mon problème existentiel à moi. Il fallait que j’arrive à sortir par le haut de cette situation, que j’en tire quelque chose de substantiel, que je n’aie pas perdu mon temps à mâcher des feuilles et à fumer des clopes.
⇒ Situation analogue, donc, mais aussi très différente, incommensurable, pour deux raisons supplémentaires qui se dérobaient à l’analyse : - parce que la sociologie elle-même (et ma présence à cet endroit) participait en fait de ce contexte d’État-nation, qui causait aux Yéménites de plus en plus de migraines. Autrement dit, les Yéménites conservaient une certaine distance à l’égard de l’exercice sociologique, ils n’y étaient pas totalement pris. Chacun conservait sa boussole de musulman, chacun à sa manière mais tout de même avec un trait commun, que je ne pouvais concevoir à l’époque (cela supposait de reconnaître l’Islam comme métacontexte* de l’histoire des idées européennes).
- et parce que moi-même, j’avais construit ma propre distance à l’exercice sociologique, instinctivement, d’une manière qui n’était pas l’islam, ou pas encore (voir en octobre 2003, les circonstances de mon premier passage à l’écriture). Et de ce fait, dans cette situation d’enquête précise, j’étais devenu le problème existentiel de Ziad : l’Occidental qu’il avait échoué à convertir, négation de la promesse de modernité, par sa simple présence, pour lui et pour lui seul.
Telles étaient les données du problème, à différents niveaux qui se rappelaient à moi chaque jour, à chaque séance de qat. Auprès des Yéménites, avec lesquels je tentais de partager mes analyses, et dont je sondais aussi les silences. Problème qui se dérobait à moi, mais que j’apprenais à démêler progressivement, à travers la thématique formelle de « l’homoérotisme »* - selon une autre obsession récurrente des Yéménites, associée à la prise de qat.
Un humoriste yéménite évoque métaphoriquement le razim°, cauchemar d’après qat impliquant presque toujours une expérience d’humiliation sexuelle. Personnifié sous les traits d’un homme (grimé de) noir, c’est ici le razim lui-même qui humilie le malheureux, pour avoir prétendu arrêter de qater…
Dans le diwan, et dans chaque situation observée, qui fait l’homme et qui fait la femme ? Qui arnaque et qui se fait arnaquer ? Question formelle élémentaire, à travers laquelle je traitais peu à peu la complexité de cette situation, démêlant les fils de ma propre histoire, ré-apprenant moi aussi peu à peu à blaguer…
Si je déteste le qat, c’est à cause de ce cauchemar, qui est celui de la modernité. Mais c’est aussi à cause des Yéménites, qui n’ont jamais voulu faire une pause et prendre du recul : considérer notre histoire comme une bonne blague, dont on rigole après coup. Il a fallu que je m’en sorte tout seul, que je leur arrache ma conversion au visage, car les Yéménites n’ont jamais voulu débrayer. Plutôt qu’accueillir ce que notre histoire disait d’eux, ils préféraient toujours qater, centrés sur leurs propres addictions, même religieuses : ils préféraient toujours qater.
Le musulman diplômé
Cette problématique n’est pas spécifiquement yéménite en réalité, même si le qat lui donne un certain relief : elle concerne plus généralement la condition de musulman diplômé. Je l’ai compris par la suite, en France au fil des années. Je l’ai compris à force de m’assoir avec eux, tentant de partager l’histoire qui me lie au Yémen. À force d’espérer la partager avec eux dans ma propre langue, en vue de la faire entendre dans mon propre pays - sauf que ce n’était jamais le moment. Il n’y avait pas de qat, mais il y avait toujours d’autres choses à faire, des choses plus importantes à discuter. À force de digérer ma frustration, j’ai fini par en voir la dimension structurelle.
J’appelle « musulman diplômé »* la subjectivité du musulman engagé dans les structures européennes, jouissant à l’égard de celles-ci d’un avantage structurel, dont il ne sait vraiment quoi faire. L’avantage agit sur lui comme une drogue, mais en réalité, il est pour lui une épreuve en ce monde (fitna).
D’une manière générale, le musulman diplômé est un connard. Pardon de le dire aussi crûment, mais la chose mérite d’être dite au bout d’un moment. Et on ne la lira jamais dans les études ethnologiques* (sur le qat ou autre), qui prennent le diplômé comme informateur* et se gardent bien d’ouvrir cette perspective. Où qu’il soit, le diplômé fait profession d’incarner sa discipline, d’en flatter les prétentions hégémoniques, alors qu’il ne songe qu’à son propre kif, son propre bien-être ici-bas. Jamais le musulman diplômé ne se hisse à la hauteur du témoignage, dans notre monde contemporain, car aucune situation ne le confronte au revers de son avantage, à la responsabilité associée. Aucune situation, si ce n’est la situation ethnographique : la rencontre d’un anthropologue venu du Nord avec un diplômé resté au Sud, captif de son propre pays, de son propre avantage postcolonial*, et soudain confronté à son impuissance. C’est ce qui rend mon histoire avec Ziad si déplaisante, si inopportune à leurs yeux.
Toi depuis ta zone, tu rêves des Yéménites comme de vaillants guerriers, solidaires de la Palestine. Depuis cette France plus ou moins périphérique, tu ne vois plus ces cohortes de diplômés, bercés dans l’habitude de jouer au plus malin, avec ou sans qat, et ainsi rendus peu à peu étrangers : à leur propre destin, à leur propre pays, et finalement arrachés à celui-ci par la guerre - mais toujours vaguement conscients des ruses de Satan qui les ont menés-là. Toi non, tu n’es plus dans la connivence, tu n’as plus conscience d’être un connard. Donc tu t’accroches à cette image, qui est une image pieuse : elle n’existe que par un acte de foi. Tu formules sincèrement le souhait d’en rester prisonnier. En cela, tu es déjà Européen.
(Merci à Badr et à Khaldoun, qui m’ont donné l’occasion d’écrire ce texte.)