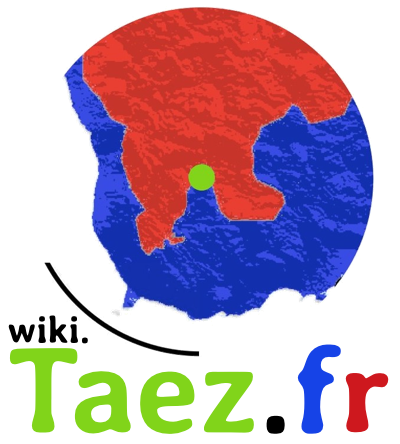Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
De la féminisation des sciences sociales
La scène se passe en mars 2006, je viens de revenir à Taez pour mon projet de thèse, et je tâte le terrain. J’allume l’enregistreur dans la pièce de Ziad, alors que nous sommes avec Abdallah, un jeune du quartier déjà évoqué dans ma maîtrise. Ziad décline l’invitation - il n’a pas l’esprit assez clair pour s’exprimer - mais je commence à interroger le jeune homme, avec mes gros sabots de sociologues. Or juste quand l’entretien va devenir intéressant, Ziad rentre en scène, et mes interlocuteurs commencent à se disputer…
Tout se joue autour d’un terme que je découvre, khannatha, traduit ici par « féminisation ». Jusque là je ne connaissais que le substantif, makhnâtha. J’apprends donc à le conjuguer à cette occasion :
Tentative d'entretien enregistré (2’10)
Voir la page du dossier « moments » pour plus de détails sur ce matériau (circonstances, exhumation). Je me concentre ici sur les implications philosophiques.
Le vertige de la honte
Lorsque j’ai redécouvert cet enregistrement, il y a maintenant cinq ans (janvier 2018), j’ai été écrasé par la honte et la culpabilité. Honte d’abord, d’avoir été cet enquêteur-là, complètement inconscient manifestement. J’avais souvent ré-écouté ce passage à l’époque de ma thèse ; il y avait même un raccourci sur le bureau de mon ordinateur pendant un temps, vers l’année 2006-2007 il me semble, car j’avais plaisir à réentendre la voix de Ziad. Mais je n’avais pas fait l’effort de traduire la discussion, et à vrai dire je l’écoutais d’une oreille distraite. Je savais qu’Abdallah faisait des allusions à mon « homosexualité », mais j’étais habitué à cette honte et je ne l’écoutais plus, elle saturait en quelque sorte ma perception. J’étais devenu extérieur à cette discussion, je ne comprenais plus ce qui s’y était dit.
Ré-écoutant la scène dix ans plus tard, le cri de douleur de Ziad me revenait frontalement au visage. Je redécouvrais ma responsabilité, cette manière délibérée de provoquer l’explicitation, en poussant Abdallah dans ses retranchements. L’extrait illustrait cette douleur morale, que je lui infligeais par ma présence plusieurs mois par an. J’étais en train de monter mes archives vidéo, pour mon film Mes adieux filmés au Hawdh. J’ai tenu à insérer cet enregistrement sonore, et c’est cette douleur que j’ai voulu exprimer dans le montage.
Évoquant ce passage quelques mois plus tard (lettre à la documentariste Nadja Harek), j’expliquais avoir été sur le moment « en mode survie », assailli par la honte et paniqué. Mais est-ce vraiment cela qu’on entend ? Bien sûr, on entend une forme de sidération : je reste comme stupide, en entendant Abdallah s’aventurer sur ce terrain. Mais suis-je pour autant « en mode survie » ?
Une interaction ordinaire
D’un point de vue relationnel, la situation est cadrée par la situation d’enquête, attestée par la présence de l’enregistreur. J’accepte tout à fait qu’Abdallah m’insulte, puisque c’est pour l’enquête : il ne fait que retourner l’objectivation, sur le mode du jeu. « Comment je te parlerais, alors que Waddah t’a féminisé ? ». Mais en même temps il me parle, il me teste, il me met au défi d’assumer. Qu’Abdallah mette en parallèle sa situation et la mienne, ça m’intéresse ! Peut-être va-t-il ainsi m’aider à comprendre pourquoi il refuse d’exercer un métier ordinaire (à la différence notamment de Yazid, le petit frère de Ziad…).
Mû par ma curiosité de chercheur, je découvre un continent encore insoupçonné : passer de l’autre côté du miroir, dans mon rapport à la société yéménite, et n’en être que plus en phase avec eux. M’installer dans une connivence, qui mettrait en abîme l’incident d’octobre 2003, et finalement le dé-réaliserait… À cet instant je touche pour la première fois cette possibilité, que j’explorerai systématiquement au fil de ce troisième terrain. C’est cela qui cause ma surprise : une stupéfaction mêlée de plaisir, qu’on devine dans le son de ma voix.
Mais déjà, Ziad fait irruption dans notre échange, avec son gémissement. Ziad intervient, pas tant pour prendre ma défense que pour se solidariser avec l’enquête, l’institution sociologique, et réintroduire de l’asymétrie. Abdallah le lui fait remarquer d’ailleurs, en soulignant la présence de l’enregistreur, mais Ziad se solidarise encore plus explicitement : « C’est la vérité : les Yéménites sont des bovins… ».
En 24:03 on m’entend rire (après les beuglements de Ziad) puis tousser, légèrement mal à l’aise. Sur un bout de papier, Abdallah s’est mis à dessiner un corps féminin, les jambes écartées : « Regarde ! On va voir si tu reconnais… » (en 24:05, non sous-titré) ; « Une chatte ! », s’exclame Ziad après quelques secondes (passage coupé). Pour épargner mon malaise, et le leur, les Yéménites bottent en touche : ils réintroduisent un corps féminin.
On ne pourrait mieux signifier la mise en abîme, qui relativise ma « féminisation ».
La féminisation comme processus
Dans l’arène des sciences sociales ces dernières décennies, les discussions méthodologiques sur le genre de l’observateur ont pris un tour de plus en plus hiératique et caricatural. On assiste toujours peu ou prou au même affrontement rituel, entre une avant-garde de la « féminisation » et une arrière-garde de « l’objectivité ».
Dans le premier camps, celui de la critique féministe et de la réflexivité*, l’argumentation va toujours dans le même sens : la féminisation c’est formidable, ça permet de « voir » quantité de choses… Dans le second, on traite ces innovations par le mépris, on se réclame des bonnes vieilles disciplines universitaires et de leurs méthodes « objectives » plus établies. Un jeu de dupes relativement réglé, où les deux camps se tiennent mutuellement en joue : les premiers essayent de ne pas trop entamer leur crédibilité scientifique, les seconds de ne pas trop passer pour des « vieux cons » - mais tout le monde se tape sur l’épaule à la fin, en mangeant des petits fours aux frais du contribuable. De fait, il peut sembler que l’Université dans son ensemble ne s’en sorte pas plus mal.
Dans ces débats entre le « voir » et « l’objectivité », on oublie une possibilité : que la féminisation rende l’observateur aveugle, d’une manière que l’objectivité ne puisse totalement compenser. Car le problème n’est pas tant de « voir » des choses grâce à la réflexivité, mais de les restituer après les avoir vues. C’est tout le paradoxe de cette interaction ordinaire, qui suscite pourtant une honte vertigineuse. Aux Yéménites, il suffit de 2’10 pour enterrer la hache de guerre, ce que quinze années d’efforts académiques n’ont pas permis à ce jour.
Et si l’on tient à se replonger dans le dossier Waddah - comme si cette honte n’était liée qu’au passage à l’acte - le problème est exactement le même. Dans ce dossier, j’ai montré que l’issue de mon premier terrain était déjà incluse dans les ingrédients de départ - la méthode ethnographique d’une part, et d’autre part le Régime, comment cette société traitait la présence du visiteur européen. Sans le passage à l’acte d’octobre 2003, il n’y aurait pas de mémoire en juin 2004 (La Théorie du Za’îm). Il fallait attraper la main tendue par Waddah - quitte à lui faire une clé de bras - ou j’aurais renié ma propre méthodologie. La féminisation méthodologique (réflexivité d’enquête*) menait inévitablement à la féminisation en acte. D’où mon retour au Yémen avec cette question : pour ressaisir cette part de mon engagement, dont l’objectivité n’avait pas su rendre compte.
L’angle-mort de l'intersexuation
Derrière les débats méthodologiques qui accompagnent la « féminisation » des sciences sociales, il se cache un problème épistémologique plus profond, à savoir : la damnation qui découle potentiellement de l'intersexuation (le véritable sens de la racine kh-n-th en arabe). Une notion très négative en islam, que certains aujourd'hui voudraient parer de toutes les vertus.
Mais cet angle-mort ne remonte pas à la révolution féministe, elle vient de beaucoup plus loin : la disqualification de la relation « maître-disciple », une mutation anthropologique survenue depuis l’An Mille, dans le rapport au savoir de la chrétienté latine, et qui marque l’identité intellectuelle européenne jusqu'à aujourd'hui (⇒Un Léviathan universitaire?)
Un maître paradoxal (épilogue)
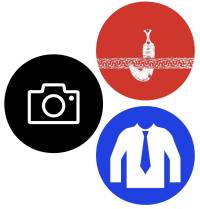
Dans cette scène avec Abdallah, il y a un jeu de rôle tout à fait cohérent, que je finirai par décrire en 2008 : un théorème de l’enchantement ethnographique (voir ci-contre). Ziad se positionne ici comme informateur, et Abdallah comme indigène, conformément à leurs niveaux d’études respectifs. Mais quelques semaines plus tard, la situation se retournera encore une fois contre Ziad. Comme après le « petit printemps arabe » de 2003, c’est lui qui devient le problème, qui devient « l’indigène », celui qui me persécute.
Trois semaines après cet enregistrement, Ziad me demande de quitter sa pièce. Cette situation est pour lui intenable, car les Yéménites veulent lever l’ambiguïté. Ziad me chasse de chez lui, non parce que je lui aurais fait des avances, mais parce qu’il refuse de me violer. Ziad me donne la liberté, et je vis cela comme une trahison.
Je romps donc avec ce milieu de la notabilité citadine, que je considère dorénavant comme malsain. Sans Ziad, je ne peux plus supporter la pression qu’ils me font subir, et je choisis mon camps : avec les commerçants du carrefour, dont l’ouverture d’esprit me permet de travailler librement. J’entame alors mon enquête sur les boutades et la vulgarité. Mais je garde une dette envers Ziad, qu’au fond de moi je n’oublierai jamais.