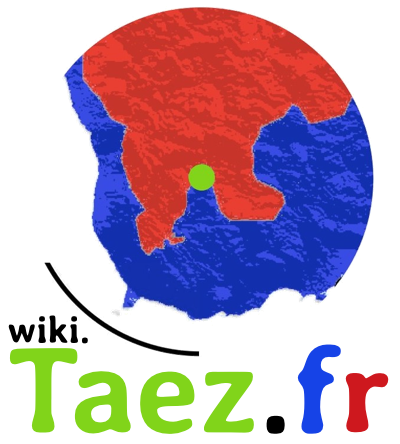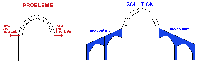Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Mawlâ : la clé de voûte de mon travail
tableau récapitulatif
| Relation ethnographique Dette du mawlâ°. |
|
| Ethnographie* réflexive* enquête par explicitation de la place occupée par l’observateur (Florence Weber) | Anthropologie historique quasi-parenté associée aux relations de clientèle (Jocelyne Dakhlia) |
| Intersexuation tant que la voute ne tient pas seule… |
|
Intuition
De qui suis-je le mawlâ? (le client, l'obligé - voir l'entrée des termes indigènes*).
C’est la question centrale, d’où les détails fournis sur ce wiki.
Dans mon travail, j’ai tenté de construire un pont entre deux orientations disciplinaires :
- l’ethnographie* réflexive*, démarche d’enquête par explicitation de la place occupée par l’observateur.
- voir Florence Weber (ENS), ma tutrice de 2002 à 2004 (qui reprendra brièvement la direction de ma thèse en 2013). - l’anthropologie historique, qui aborde l’histoire islamique avec des questions anthropologiques transversales - en l'occurrence, la quasi-parenté associée aux relations de clientèle.
- voir Jocelyne Dakhlia (EHESS), qui dirige mon travail de 2004 à 2012.
La clé de voûte, c'est la condition de mawlâ :
Dès 2005 (première année de thèse), j’identifie une analogie formelle entre ma première enquête (2003) et l’intrigue des Barmécides , clients des premiers califes abbassides (IIe siècle de l’Hégire). À mon retour (2006), je tente de réactiver mon alliance avec Ziad. L’année suivante (2007), j’apprends que Ziad a été interné : je me convertis à l’islam, et garde depuis un lien étroit avec cette famille.
La clé de voute, c’est la dernière pierre, celle qui assure la stabilité de l’ensemble. Une fois qu’on l’a posée, tout est plus simple ; avant tout est compliqué… Sur ce wiki, je décortique en détail ma condition d’intersexuation - mais l’enjeu véritable est de faire le pont entre ces deux branches de l’anthropologie : pour que la société yéménite ne soit plus « ailleurs » dans le temps et dans l’espace, pour la ramener dans le monde contemporain - du moins dans notre monde contemporain (la guerre en Ukraine a déjà tout changé…).
Pourquoi la condition du mawlâ est-elle tabou (autant pour les sciences sociales que pour les musulmans, qui en entretiennent chacun une vision idéalisée) ? Depuis quinze ans, qu’est-ce qui m’empêche de poser cette dernière pierre ? La question (celle des rapports entre islam et sciences sociales) est de nature cybernétique*. D’où une perspective originale, sur notre monde et sur l’époque que nous traversons.
De la dette ethnographique
Sur le terrain, tout anthropologue contracte des dettes ethnographiques, des dettes liées au processus d’apprentissage. À l’époque coloniale, ces dettes étaient réglées par la rémunération des informateurs, et par les retombées bénéfiques pour l’autorité locale qui avait consenti à cette présence sur son sol. Rien de tout ça à l’époque post-coloniale, à l’heure du « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » : le rapport ethnographique est censé être égalitaire, établi librement par deux volontés autonomes, dont les motivations doivent être reconnues et respectées. C’est ce défi que j’ai eu à cœur de relever, dont découlent toutes les complications évoquées sur ce wiki.
Les sciences sociales ne peuvent avoir prise sur le monde sans reconnaissance de la dette ethnographique. « Si c’est gratuit, c’est vous le produit », dit l’adage de l'ère cybernétique… Si le problème ne se pose pas, alors vos sciences sociales ne sont qu’une fiction, dans laquelle on maintient les Européens par affection, pour être gentil avec eux ; une fiction projetée à l’échelle du monde dans leurs subjectivités, toujours plus étriquée dans la réalité.
Depuis vingt ans, je me bats pour que la relation qui me lie à quelques personnes, à une famille particulière et à la société locale du Hawdh al-Ashraf, dans la ville de Taez au Yémen, accède au statut d’objectivité. Pour qu’elle ne soit pas « l’histoire personnelle de Vincent », pour qu’elle engage les institutions académiques, au nom desquelles je me suis engagé là-bas. L’injustice que je subis depuis quinze ans, que nous subissons mes interlocuteurs et moi, engage la société française et son rapport au monde. Elle engage la possibilité que notre société soit en relation avec ce qui la dépasse, ce qui ne lui est pas complaisant.
Déjà mon premier mémoire racontait l’histoire d’une relation impossible, une relation empêchée par un « stigmate » - je ne savais nommer autrement ce qui l’avait fait tourner court. Ces dernières années, j’ai révélé le subterfuge - une fiction de viol gagée sur mon homosexualité - qui a tout de même permis l’écriture cette année-là (octobre 2003), et mon retour toutes les années suivantes. Mais je n’ai pas été violé et je ne suis pas homosexuel, tous les protagonistes le savent parfaitement.
Au fil des années, les épreuves ont renforcé nos rapports, la certitude d’avoir un destin commun. À mesure que les enjeux se déployaient dans l’Histoire de plus en plus clairement, s’affinait aussi notre conscience de ce qui nous empêche.
L’enjeu fondamental de toute l’histoire, c'est la possibilité que la dette ethnographique se superpose à la condition de mawlâ°. Le mawlâ qui n’est pas un esclave, mais qui n’est pas totalement affranchi non plus : qui conserve des dettes à l’égard du monde, à l’égard de ceux qui lui ont permis d’être ce qu’il est. Ce qui bloque c’est la possibilité que l’Occident* entretienne ce rapport-là, à l’Islam et aux mondes qui le précèdent. Plutôt qu’une « repentance », une dette consciemment assumée à l’égard du monde. N’être pas né de la cuisse de Jupiter, mais avoir germé quelque part, sur telle branche, dans l’arbre de l’Histoire des hommes.
Définition du mawlâ
Entrée “client” des termes indigènes :