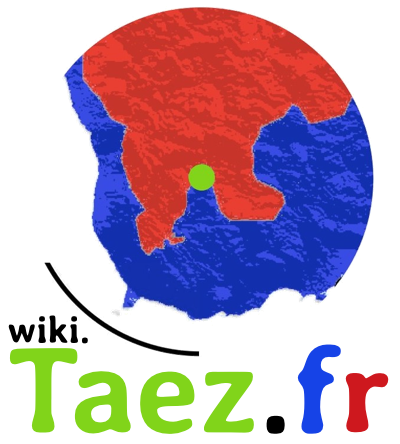Ceci est une ancienne révision du document !
Ethnographie
Autrefois, l'ethnographie désignait la collecte écrite des « faits de culture », par différents types d'acteurs de terrain : érudits locaux, missionnaires ou administrateurs coloniaux. Cette conception est progressivement remise en cause, dès la révolution Malinowskienne des années 1920, qui prône l'immersion du chercheur-théoricien en personne.
Aujourd'hui, l’ethnographie désigne plutôt une démarche expérimentale, conçue pour palier l’insuffisance des sources écrites dans l’approche d’un univers social donné (ethnos), à travers l’engagement personnel du chercheur qui tient son journal (graphein).
Notons que le Yémen n'est évidemment pas une société sans écriture. Seule la décrédibilisation terminale des traditions orientaliste, ethnologique*, mais aussi des réactions nationaliste et islamiste - fiasco incarné par les attentats du 11 septembre 2001 - rendait concevable d'exporter la méthode ethnographique sur le terrain yéménite. Démarche qui aboutit, assez logiquement, à la redécouverte du fait monothéiste*.
Autrefois cantonnée à l’étude des sociétés exotiques ou du folklore, l’ethnographie est aujourd’hui le lieu privilégié d’une réflexion sur les sciences sociales et leurs fondements empiriques.
L’adjectif « ethnographique » a donc deux sens :
- sens ancien (que je n’utilise jamais, chez les partisans de l'ethnologie) :
relatif à la description culturaliste des pratiques d’une peuplade donnée.
= l'écriture de « pratiques culturelles » situées. - sens actuel :
relatif à l’exercice réflexif* et aux conditions de possibilité d’une écriture scientifique située.
= comprendre ce que l'écriture fait aux situations.