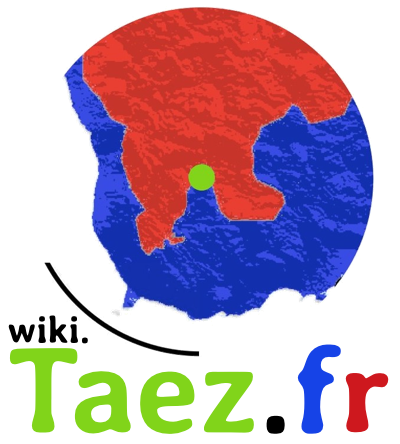Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
L’engagement symétrique
En vue d’une perspective renouvelée (épistémologique) sur le monde contemporain, sur son histoire et sur le moment historique que nous traversons, je propose au lecteur de m’accompagner dans le double engagement qui est le mien depuis quinze ans :
- témoignage laïque au sein de la communauté musulmane
- témoignage musulman au sein des sciences sociales
Un mûrissement ethnographique
À l’origine, il y a une démarche postulant l’égalité épistémique entre les partenaires de l’interaction ethnographique* (anthropologie symétrique) :
- pas d’infériorité rationnelle des interlocuteurs sur le chercheur
- pas d’infériorité spirituelle du chercheur sur ses interlocuteurs
Mise en pratique dans la société yéménite à partir de 2003, cette démarche se concrétise sur l’enquêteur par deux circonstances marquantes :
- juin 2004 : conversion subjective à l’homosexualité pour persévérer dans l’enquête
- septembre 2007 : conversion à l’islam pour me retirer du terrain
Ces deux circonstances découlent de l’engagement initial. Elles ne relèvent donc pas d’un « cheminement personnel » du chercheur, mais de son exposition aux contraintes structurelles de l’engagement ethnographique :
- À la fin de mon premier séjour (octobre 2003), je n’ai pas d’autre choix que de subir un rapport homosexuel pour sauver la face - et je suis incapable à l’époque d’expliquer pourquoi. Mon retour est donc compréhensible et légitime aux yeux de la société locale, malgré cette conversion subjective à l’homosexualité.
⇒ Dans cette situation, je contracte au fil de mon enquête une dette morale considérable, surtout auprès de certains interlocuteurs identifiés comme responsables de l’incident, tandis que la société locale continue de couvrir ma présence. - Au terme de mon enquête, je dois admettre que ma pratique des sciences sociales s’est toujours identifiée tacitement à l’imputation de mon viol. Par ma conversion à l’islam, je prends acte du caractère structurel de cette situation.
⇒ C’est ce qui permet mon désengagement, à charge d’assumer ma dette par d’autres moyens, au sein de la Communauté.
Usure de la laïcité
Pendant de nombreuses années, je me suis abstenu d’insister sur ces deux circonstances. Mais la restitution de cette expérience ethnographique s’est constamment heurtée à deux mythes, ou prétentions « totalitaires », qui structurent par défaut les sphères d’argumentation :
- soit la victoire de la religion sur la science, univoque et définitive (qui ne supporte donc pas mon passage par l’homosexualité).
- soit la victoire de la science sur la religion, univoque et définitive (qui ne supporte donc pas ma conversion).
Cette habitude de juxtaposer les registres plutôt que de les articuler nous a enfoncé dans une impasse. Au nom de la laïcité, on demande aux musulmans de :
- faire témoignage laïque dans les institutions laïques
- faire témoignage musulman au sein de la communauté musulmane
Ce n'est franchement pas très intéressant… Cette contrainte, nous savons parfaitement nous y plier. Mais peu à peu la laïcité comme l'islam finissent par tourner à vide, ce qui est pire que tout. Il est peut-être temps d’en prendre acte, à l’heure où la guerre d’Ukraine met à mal nos alliances géostratégiques au Moyen-Orient. La valeur de l’engagement ethnographique est précisément d’opérer des arbitrages entre des prétentions discursives contradictoires, pour les réinscrire dans un monde en commun.
L’insistance sur ces deux circonstances est inconfortable à bien des égards, mais elle a l’avantage d’aller à l’essentiel, de désamorcer d’emblée ces prétentions discursives et de frayer un chemin vers le réel, à travers la complexité.